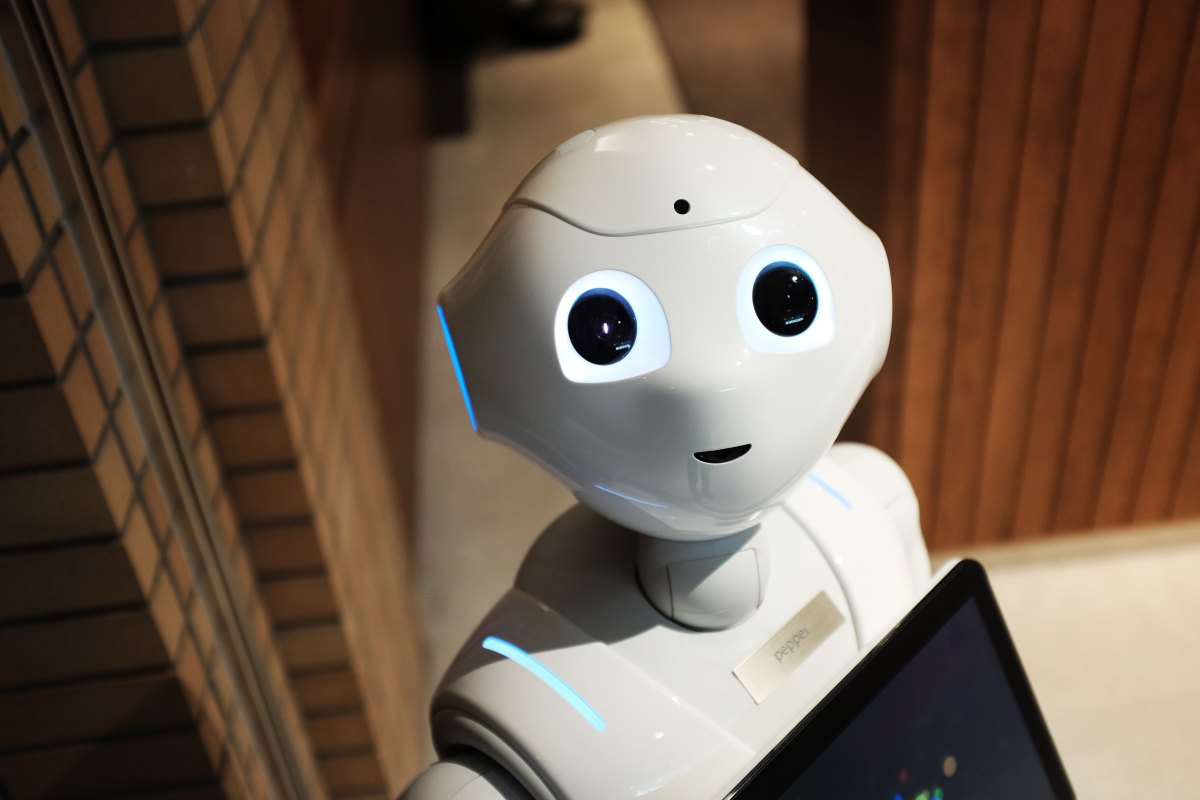Un texte de Jérôme Sainton
Docteur en Médecine, Ex Ingénieur Informaticien
Ancien élève de bioéthique de l’IPLH
Introduction
Le sophisme sur lequel repose l’oxymore du « mariage asexué » a l’intérêt de révéler un point essentiel de notre civilisation. Le sophisme est le suivant : on énonce que le mariage ne reposerait que sur une *construction* (« culturelle ») au motif qu’il a été institutionnalisé différemment selon les civilisations. Sous prétexte donc qu’un *donné* (de « nature ») aurait été assumé différemment selon les cultures, ce donné serait non signifiant en lui-même. Et ça prend. Et c’est ainsi qu’aujourd’hui on peut nous proposer (nous imposer), non pas d’intégrer ce donné (la sexuation, la génération) de façon différente et nouvelle, mais, et c’est très différent, de ne pas l’intégrer — et d’être dans le fantasme. Ne pas intégrer le réel, voilà ce que nous observons à travers cette évolution, c’est-à-dire à quel point notre civilisation se caractérise par sa déconnexion du réel. [0A]
Cette évolution (cette involution) de notre société se fait subrepticement. Elle se fait, en effet, plus qu’on ne la fait. Car imposer aujourd’hui une pensée déconnectée du réel ne requiert aucun effort particulier pour un pouvoir idéologique quel qu’il soit (c’est l’opposé qui exigerait aujourd’hui une intelligence et une volonté hors du commun). Le sociologue et théologien Jacques Ellul, que je me propose de convoquer, expliquerait comment un tel mouvement, impossible dans une autre civilisation que la nôtre, exprime au contraire ici un conformisme absolu. Conformisme à la fois à l’absence de sens et aux structures de notre époque, lesquels nous sont l’un et l’autre donnés par le centre de gravité de notre société : la Technique. [1] En effet, avant de former (pour former) une société athée, ultralibérale, consumériste, artificielle, virtuelle, etc., nous formons une société technicienne. Or, le propre de la Technique moderne [2] est justement d’opérer sur le réel indépendamment de ses finalités, de le plier à un calcul, de le déconstruire … et de le reconstruire.
Approche sociologique : une médiation exclusive
« Tant que les techniques des sociétés traditionnelles étaient sporadiques et fragmentaires, elles représentaient des médiations singulières. La situation a changé avec la multiplication des techniques et le développement du phénomène technique [;] cette médiation devient exclusive de toute autre : il n’y a plus d’autres rapports de l’homme à la nature, tout cet ensemble de liens complexe et fragile que l’homme avait patiemment tissé, poétique, magique, mythique, symbolique disparaît : il n’y a plus que la médiation technique qui s’impose et devient totale. […] [En] conséquence, la relation entre la Technique et l’homme est une relation [elle-même] non médiatisée. La conscience, sociale ou individuelle, aujourd’hui est formée directement par la présence de la Technique, par l’immersion de l’homme dans ce milieu, sans la médiation d’une pensée pour qui la Technique ne serait qu’un objet, sans la médiation d’une culture. La relation à la Technique est immédiate, ce qui veut dire que maintenant la conscience est devenue le simple reflet du milieu technicien. » [3]
Ellul explique que la technique moderne est devenue une médiation exclusive, par opposition aux techniques des sociétés traditionnelles. Toute notre société récente a été bâtie à partir de cette médiation. C’est très important pour comprendre comment cette société « évolue » maintenant. Il ne faut pas comprendre celle-ci comme une société traditionnelle à laquelle s’ajouteraient un ensemble de procédés, de machines, de modes de travail et de communication … La société, la civilisation de la technique, est d’abord marquée par la cohérence de l’ensemble technique qui la constitue et qui constitue aujourd’hui le milieu de l’homme. Ce milieu informe ensuite son intelligence, et conditionne son rapport au réel, et il adapte l’homme aux nécessités de la Technique. La société moderne n’évolue donc pas comme si la technique n’était qu’un ensemble de moyens surajoutés à une réalité demeurée autonome et libre à son égard. C’est le contraire. Mais, par compensation d’un phénomène qui lui échappe, pour lors à peu près complètement, l’homme moderne prétend faire l’évolution (voire la révolution). [4]
En fait, il ne fait qu’exprimer la réduction de son intelligence à une compréhension purement technique de la réalité : comment ça fonctionne et à quoi ça sert. [5] Dès lors, la totalité du réel se ramène à une série de problèmes à résoudre en terme de rationalisation et d’organisation, les interrogations existentielles qui porteraient sur l’homme en tant que sujet et sur le sens à donner à sa vie étant supprimées [6] au profit de questions bien plus fondamentales dans un milieu technicien, à savoir celle de la puissance et celle de l’efficacité pratique qui sont promises par la rationalisation de la pensée et l’organisation du monde. Ainsi pour les réalités du mariage, de la filiation, de la sexualité, de la procréation : voilà autant d’éléments à rationaliser et à organiser du « mieux possible », comme n’importe quoi d’autre. [7] D’où l’évidence des techniques mécaniques dissociatives de ces réalités : contraception, PMA, GPA … D’où celle des techniques psychologiques constructivistes de ces réalités : parentalité, « Genre » … L’« homoparentalité » en particulier est un concept purement technique, l’aboutissement logique et nécessaire de la dissociation de la sexualité et de la procréation par la technique, en même temps que de l’effacement de la complémentarité des sexes par l’uniformisation des tâches dans la société de la technique.
Les « agents de transformation sociale », comme ils se plaisent à se désigner eux-mêmes, [8] n’ont donc rien imposé qui ne se fait déjà sans eux : dans une civilisation non technique, ces agents auraient été inaudibles ou ridicules. Pour réussir à ne plus (faire) comprendre la famille que comme un ensemble d’interactions asexuées, il fallait que la famille ait déjà symboliquement disparu pour n’être plus qu’un sous-système du système technicien — à l’intérieur duquel « parent 1 » et « parent 2 » font aussi bien l’affaire que « père » et « mère », les notions de « projet parental » et de « désir d’enfant » ayant accompagné la réduction de la notion de « parents » à une simple quantité (le chiffre deux), après avoir évacué celles, accessoires dans une société technicienne, de la différence sexuelle (un homme et une femme), de la complémentarité (un père et une mère) ou de la fécondité (un géniteur et une génitrice). C’est bien pourquoi au demeurant, la seule « révolution » à faire consiste, pour ces courageux agents, à à adapter le Droit à la réalité … de la société technicienne. [9]
Approche philosophique & morale : l’intolérance absolue des limites
« La technique [moderne] est en soi suppression des limites. Il n’y a, pour elle, aucune opération ni impossible ni interdite : ce n’est pas là un caractère accessoire ou accidentel, c’est l’essence même de la technique : une limite n’est jamais rien d’autre que ce que l’on ne peut pas actuellement réaliser du point de vue technique – simplement parce qu’il y a au-delà de cette limite un possible à effectuer. Il n’y a jamais aucune raison de s’arrêter à tel endroit. Il n’y a jamais aucune borne délimitant un domaine autorisé : la Technique joue dans l’univers qualitatif exactement comme les fusées dans le Cosmos […] La Technique est […] un phénomène qui se situe dans un univers potentiellement illimité parce qu’elle-même est potentiellement illimitée : elle présuppose un univers à sa propre dimension, et par conséquent ne peut accepter aucune limite préalable. » [10]
« [D’où cette] certitude dans l’espoir, qui étonn[e] en ces temps troublés [:] c’est la vertu du “Tout est possible” [:] non seulement il n’y a pas de limite préfixée, de limite morale ou spirituelle à l’action, mais encore la seule barrière reconnue est celle de ce qui n’est pas aujourd’hui possible mais le sera demain. Rien ne surprend plus : la désintégration de l’atome, le Spoutnik, tout cela c’est dans l’ordre normal. Demain on fera mieux. Mais en réalité cette vertu exprime surtout une morale de la démesure, une morale de l’illimité à laquelle l’homme moderne s’est parfaitement adapté. La démesure des moyens et des réussites techniques conditionne une morale du gigantesque et de l’illimité. […] Le Bien apparaît alors dans le franchissement de la limite : ce que l’on ne peut pas faire aujourd’hui, on le pourra demain : et cela est bien. » [11]
La Technique moderne est en soi refus des limites. Elle ne connaît pas de limite préfixée à son action — au contraire de l’antiquité grecque par exemple où l’action s’inscrivait dans un ordre (cosmique). La conséquence est automatique : la limite à l’action ne signifie plus aujourd’hui ce que l’on ne doit pas faire, mais ce que l’on ne peut pas (encore) faire. Le Bien lui-même est devenu refus et franchissement des limites. On ne saurait donc par hypothèse accepter aucune limite spirituelle ou morale.
La « liberté de la recherche » exprime exactement cette intolérance parfaite des limites. [12] La seule limite reconnue est l’impossibilité actuelle, donc précisément ce qu’il faut dépasser. La récente révision de « loi » portant sur la recherche sur l’embryon exprime à fond cette intolérance absolue des limites. Cette révision pulvérise le maigre interdit symbolique de la version précédente qui, tout en organisant la vivisection de l’homme embryonnaire, posait qu’il s’agissait néanmoins là d’une exception au principe fondateur de la dignité humaine. Mais aucune limite ne saurait être concédée, même purement symbolique. [13] Et c’est toute la société qui a ratifié cette intolérance, notamment par le détour de la santé, qui ne fonctionne plus qu’en terme de réussites et d’échecs à l’encontre des limites. D’où la réification de l’homme embryonnaire pour la recherche, mais encore les PMA à 4 ou 5 « parents », et bien entendu, on ne peut plus logiquement, le « traitement » de « l’infertilité sociale » des couples asexués par la PMA-GPA : étant donné que ce qui est moral, c’est de se battre contre l’impossible, « au nom de quoi » interdirait-on le recours à toutes les techniques possibles ? [14]
Cette volonté de franchir les limites, de les supprimer, c’est la vertu du « tout est possible », qui aboutit à trois choses : une intolérance infantile à la frustration, l’effacement de l’altérité (ce qui place l’homosexualité comme un modèle de choix), et (c’est le corollaire de l’intolérance à la frustration) l’obligation de moyens — l’impératif moral catégorique de notre époque, la seule obligation qui vaille aujourd’hui : obligation de moyens et non de sens (surtout pas!) : l’État est sommé de mettre à disposition pour tous les même moyens : telle est l’implacable logique actuelle. [15]
La synthèse postmoderne : un « libre-choix » bien conforme
« L’homme ne peut se situer nulle part d’où il pourrait porter une appréciation sur ce processus. Il n’a aucun “point de vue” possible. S’il pense dialectiquement, la technique n’est pas un des termes de cette dialectique : elle est l’univers dans lequel joue la dialectique. […] Tous les choix se font à l’intérieur du système, et rien ne l’excède. » [16] « [Ainsi de la “libération sexuelle” :] les malheureux jeunes qui croient affirmer par là leur liberté ne réalisent pas qu’ils se bornent à exprimer strictement leur appartenance au système : ils réduisent le partenaire à l’objet donnant une satisfaction, comme n’importe quel produit technique, et l’inconstance du choix ne fait que rejoindre le kaléidoscope de la consommation. Ils ne font aucun choix autre que celui que propose le système technicien. » [17] « Si bien que nos modernes zélateurs pour l’abolition de la morale sexuelle, de la structure familiale, du contrôle social, de la hiérarchie des valeurs, etc., ne sont rien d’autre que les porte-paroles de l’autonomie technicienne dans son intolérance absolue des limites quelles qu’elles soient : ce sont de parfaits conformistes de l’orthodoxie technicienne implicite. Ils croient combattre pour leur liberté mais en réalité, c’est la liberté de la technique, dont ils ignorent tout, qu’ils servent en aveugles esclaves du pire des destins. » [18]
« La soi-disant libre pensée n’est [ainsi] qu’un tissu de conditionnements d’autant plus rigoureux qu’ils ne sont pas entrevus [:] elle consiste à récuser un système (religieux) non pour entrer en conflit contre les déterminations profondes, mais pour se livrer à [celles de la technique] en toute ignorance. » [19]
Depuis un moment déjà, mais surtout depuis une cinquantaine d’années, on nous dit : mais tout cela, voyons c’est le progrès, c’est la liberté, c’est donner un « libre-choix » à chacun. Sauf que dans ce « libre-choix », comme l’ont montré Ellul et bien d’autres, la liberté est confondue avec la puissance, [20] le fantasme ou le passage à l’acte, tandis que le choix est réduit à n’être plus qu’un choix de consommation. [21] C’est-à-dire que ces libertés et ces choix se bornent à exprimer les déterminations les plus étroites du système technicien. Le système assume et résout ainsi le paradoxe de la liberté par le conditionnement. Et dans le même temps, ce non-conformisme fonctionnalisé permet à l’homme de compenser la fatalité de l’ordre technicien. Telle est la synthèse de la liberté postmoderne — dont la « libération sexuelle » offre le parangon.
On comprend ainsi de quelle façon, par quels moyens, s’instaure l’actuelle « dictature du relativisme ». [22] La contradiction n’est qu’apparente. D’un côté, l’autonomie technicienne exige un état d’esprit conforme à la suppression des limites. De l’autre on prétend pouvoir voler dans le vide moral, et l’on se retrouve ainsi gouverné entièrement par la seule gravitation technicienne. Le « libre-choix » moderne a finalement tout de l’hétéronomie kantienne. Elle est le faux-semblant de la liberté. Redéfinie en liberté de consommation, c’est une liberté qui n’a ni forme ni contenu, et qui se confond de la sorte parfaitement avec la technique. Telle est l’essence du « libre-choix » de la Modernité : penser de plus en plus techniquement son rapport au monde et à soi, pouvoir de plus en plus exercer des choix techniques, user de plus en plus techniquement des choses, organiser de plus en plus techniquement sa vie, etc. … et ne plus pouvoir faire autrement [23] : le « libre-choix » est un « serf-choix ». [24]
Conclusion, l’homme de l’attente est l’homme de l’espérance
Pour conclure, il ne me reste plus qu’à relier toute cette réflexion d’un homme libre au combat pour la (vraie) liberté. Les Veilleurs se réjouiront de savoir que, pour Jacques Ellul, l’homme de ce combat, c’est l’homme de l’espérance, celui qui sert le monde par son attente : une attente confiante et inébranlable, résolue et patiente.
« L’homme de l’espérance est l’homme de l’attente. […] Cette attente n’est pas une affaire intérieure et cachée. Elle n’est pas simple oraison dans le fond du cœur. Job avait ses témoins qui étaient ses accusateurs, en étant ses amis. L’homme de l’attente doit rendre cette attente “é-vidente”, il doit prendre à témoin, et risquer sa réputation, risquer de passer pour un imbécile littéraliste, un faible d’esprit influencé par l’Apocalypse, un névropathe, ou un obsédé. Il doit savoir que le jugement contre lui sera aussi radical que son attente : car s’il y a une chose que notre société ne peut pas accepter, parce qu’elle est efficace, productiviste, activiste, politique et triomphale, c’est exactement cette attitude-là : elle peut tout accepter […], elle peut tout absorber, sauf exactement celui qui s’est fermé dans son attitude du radicalement autre, et qui a jeté son ancre dans des eaux extérieures, qui espère ce qu’aucune évolution de l’histoire ne pourra jamais lui apporter, qui récuse en même temps le matérialisme historique, l’idéalisme politique, et le structuralisme [— aujourd’hui : le Genre —] fatal … Et qui, de ce fait, n’a plus aucune commune mesure avec la construction de ce temps, mais qui sert le monde par l’attente — et par la seule attitude, seule décision parfaitement inassimilable, située en dehors […] [dans] la récusation de tout ce qui n’est pas l’attente […] du royaume qui vient [et du Tout-Autre]. » [25]
![]()
Notes de bas de pages
[0] Mon sous-titre s’est imposé de lui-même, avant de réaliser qu’il venait en écho à Olivier Rey et son maître ouvrage : Itinéraire de l’égarement : du rôle de la science dans l’absurdité contemporaine, 2003. Sur la relation réciproque et nécessaire actuelle entre science et technique, cf. le même ouvrage (ou encore Jérôme Sainton, La morale technicienne : l’illusion bioéthique et le refus de la transcendance, sous la direction d’Olivier Rey, mémoire de bioéthique, IPLH, 2013).
[0A] « La caractéristique essentielle de notre temps ? — Une désincarnation. Alors que l’inverse constitue l’homme. » (Bernard Charbonneau, Prométhée réenchaîné, 2001 (1972), p. 53)
[1] Pour résumer ceci de façon sociologique, à la manière d’Ellul : dans la société moderne, il faut distinguer plusieurs niveaux. Au niveau des apparences, certes il y a beaucoup de changements. Mais si l’on se place au niveau des structures, ce fond reste extrêmement stable. Car au niveau des événements et du circonstanciel (le niveau politique), on en reste à la surface des choses, avec beaucoup d’agitation — ce que certains appellent « le changement ». Il y a ensuite le niveau des variations de grande amplitude (les phénomènes économiques par exemple). Mais les structures stables (la profondeur de l’océan) sont données par la technique : « c’est elle qui structure fondamentalement la société moderne. Non pas que la technique ne change pas, mais elle obéit à sa propre loi d’évolution et elle est très peu influencée par les événements. » (Jacques Ellul, Ellul par lui-même, 2008, p. 112). Et, aujourd’hui, « c’est le conformisme à la technique qui est le vrai conformisme social » (Jacques Ellul, Le Système Technicien, Calmann-Lévy, 1977, p. 122). Il est encore courant de s’entendre dire que notre univers technique n’est qu’un ensemble de moyens dont on dispose. En réalité, c’est cet univers, ce sont ces moyens, qui nous disposent. D’où l’absurdité de ce monde ; car l’agir technique pur déconstruit rien moins que ce qui préside à son harmonie.
[2] Avec Ellul, nous n’entendons pas par « la Technique » l’outil ou même la machine, aussi perfectionnés soient-ils, mais l’ensemble, la systématisation de ces moyens, et le principe d’après lequel, en conséquence, la société de la technique règle son action et sa pensée.
[3] Le système technicien, p. 43-47.
[4] Cf. l’exemple type de la « refondation de l’école » par M. Peillon (note n°24) qui a publié comment la révolution française n’est pas terminée (2008). La révolution dont il s’agit relève d’un conformisme absolu au mouvement de la société technicienne, que l’on appelle ensuite « le sens de l’histoire », mais l’on subvertit et l’on renverse ainsi le sens même de la « révolution », depuis le Communisme en fait, où « ce mot prend un sens exactement contraire à son sens originel : faire la révolution, c’est s’adapter au donné. Elle n’est plus la liberté mais la nécessité. » (Bernard Charbonneau, Prométhée réenchaîné, 2001 (1972), p. 277-278) Combien plus encore, depuis, la « révolution » sexuelle ! Cf. le triptyque de Jacques Ellul : Autopsie de la révolution ;De la révolution aux révoltes ; Changer de révolution.
[5] À la différence d’une intelligence philosophique (ce que c’est), symbolique (ce que ça signifie) ou encore poétique (ce que ça donne à imaginer). « La formule [“civilisation technique”] est exacte, il faut en mesurer l’importance : civilisation technique, cela signifie que notre civilisation est construite par la technique (fait partie de la civilisation uniquement ce qui est l’objet de la technique), qu’elle est construite pour la technique (tout ce qui est dans cette civilisation doit servir à une fin technique), qu’elle est exclusivement technique (elle exclut tout ce qui ne l’est pas ou le réduit à sa forme technique). » (Jacques Ellul, La technique ou l’enjeu du siècle, 1954, p. 116)
[6] « Au total, la suppression du sujet et la suppression du sens sont deux conséquences importantes de la technique et contribuent au malaise et au malheur de l’humanité. » (Ellul par lui-même, p. 82)
[7] « Pour utiliser le mieux possible les techniques et leur rendement, il faut être capable d’organiser la société d’une certaine façon, être capable de mettre les gens au travail d’une certaine façon, de les amener à consommer d’une certaine façon. » (Ellul par lui-même, p. 120) Et il en va de toute chose dans la société que sous-tend la Technique. Exemple de l’art, avec cette critique de Jacques Ellul à l’encontre de l’art moderne, dénoncé à partir des choix des organisateurs d’une « exposition pop » en 1969 : « selon la pente du système technicien, d’un côté, le fond n’a aucune d’importance, le sujet est sans intérêt, de l’autre ce n’est pas l’artiste en tant que sujet qui compte : la conformité au système technicien est flagrante, on n’a pas à se demander ce que l’on fait, il faut le faire le mieux possible. » (L’empire du non-sens, PUF, 1980, p. 156-157). Exemple de l’activité « des journalistes de bonne foi [qui] veulent faire passer le mieux possible l’information dont ils sont chargés », mais qui ne parviennent qu’à amplifier « l’insidieuse marée engluant notre pensée et notre existence […] parce que des techniciens de bonne foi, engagés dans l’utilisation d’instruments à images, font le mieux possible leur métier sans se poser d’autres questions. » (La Parole humiliée, Seuil, 1981, p. 143-144). Le 12 février 2013, interrogé au journal de France 2 sur la demande d’une PMA par un couple lesbien, Christiane Taubira a répondu : « Cette demande étant légitime, nous devons y répondre le mieux possiblepour la société [aussi] le gouvernement aura le souci de traiter le sujet de la façon la plus complète, la plus juste et la plus efficace possible. » (je souligne)
[8] Cf. Marguerite Peeters, La mondialisation de la révolution culturelle occidentale, 2007.
[9] Toutes les déclarations des ministres en charge de la redéfinition du mariage pour tous, ne disent en fait qu’une seule chose : « Nous faisons une loi qui s’adapte à ce qu’est la réalité de la société » (Dominique Bertinotti, France Inter, 07/11/2012) « La loi ne va pas créer quelque chose de nouveau. Elle ne fait que s’adapter à des évolutions de société profondes […]. Des couples ont recours à la procréation médicalement assistée […]. La révolution silencieuse des familles a déjà eu lieu. Ce qui nous est demandé aujourd’hui, c’est d’adapter le droit. » (JDD, 15/12/2012) On ne saurait mieux reconnaître la défaite de la pensée et l’autonomie de la Technique, dont les évolutions induites se justifient ensuite les unes les autres mécaniquement : en substance, puisque on fait déjà des PMA (en bricolant éventuellement avec des gamètes issus de couples différents), puisqu’on a déjà inventé le « projet parental », l’« homoparentalité » est déjà justifiée. Et c’est tout-à-fait vrai. Aujourd’hui le dispositif Taubira ne fait « que » se mettre en cohérence avec une intelligence purement fonctionnelle de la famille. Tout n’est qu’affaire d’adaptation à cette société-là, on ne cesse de nous le répéter. Et maintenant que la loi et le droit sont davantage adaptés à réalité de la société technicienne, il reste à faire de même avec l’homme à venir. Et Ellul de décrire le travail actuel de Vincent Peillon (comme des ministres qui l’ont précédé) à l’éducation : « Le but principal aujourd’hui de l’enseignement et de l’éducation, est de préparer des jeunes adaptés à cette société. » (Le Vouloir et le faire, p. 156). Cf. note n°24.
[10] Jacques Ellul, Le système technicien, p. 167 (= 2012, p. 160).
[11] Jacques Ellul, Le vouloir et le faire, 1964, p. 159-160. Et, du fait que cette règle de conduite se trouvât « parfaitement adaptée aux exigences de la société moderne », Ellul concluait déjà à « une morale totale et globale de la société toute entière. Il s’agit d’une Morale collective essentiellement totale et même totalitaire. Il s’agit d’une morale qui atrophie progressivement les vertus privées, la morale personnelle, et qui aboutit à la disparition du sens moral individuel dans la mesure même où elle fait disparaître la problématique. » (ibid.) cf. la « morale laïque » de Vincent Peillon (note n°24), soutenue par François Hollande le 9 octobre 2012 à la Sorbonne et dont la « présidence normale » donne une saveur supplémentaire au propos d’Ellul : « Dans la société technicienne, le Normal tend à remplacer le Moral » ; une Norme qui « n’est plus un Impératif de la conscience [mais qui] est obtenue par le comportement moyen ». Or, « du moment qu’un comportement est Normal, il n’y a pas lieu de le réprouver au nom de la Morale » puisque « la vertu la plus haute demandée à l’homme d’aujourd’hui est l’adaptation » (Le Vouloir et le faire, p. 156). Cf. note n°11.
[12] Avec au mieux de la naïveté, sinon beaucoup d’hypocrisie. Car si « tout le monde est d’accord pour déclarer que la recherche scientifique doit être libre et indépendante » (Le système technicien, p. 168 (= 2012, p. 160)), il est un fait que « la Science cesse d’être libre. Elle est fortement polarisée dorénavant : elle a un devoir absolu, servir l’Économie nationale. […] C’est une question de vie ou de mort dans la concurrence des nations, mais aussi pour la Science elle-même. Il n’y a plus de “Science pour la Science”, Il y a une Science pour le développement. » (Le Bluff technologique, 1988, p. 336)
[13] La société technicienne a bien sûr déjà vidé le symbolique de sa substance et de sa force, comme en témoigne, dans le langage actuel, toute la valeur de l’expression « purement symbolique ».
[14] « Au nom de quoi » : telle est l’expression récurrente des techniciens exprimant l’intolérance absolue des limites par la Technique. Cf. Bernard Debré, le 09/02/11 (synthèse de presse de Genethique.org) : alors qu’un amendement au projet de loi en cours sur la bioéthique prévoyait de limiter à trois le nombre de fécondations des FIV afin d’« éviter un trop grand nombre d’embryons surnuméraires », il déclarait aussitôt : « Je ne vois pas au nom de quoi on limiterait le nombre d’embryons à féconder. » Cf. Ellul : « Et, je vous le demande, au nom de quoi s’arrêterait-on ? » (Sans feu ni lieu, 1974, p. 227) « au nom de quoi — puisque précisément Dieu est mort ! » Or, « la proclamation de la mort de Dieu permet à la dure concrète implacable réalité de ce monde de se présenter comme Dieu, de se faire adorer, servir », puisque « Dieu […] est redevenu Moloch. Car le Dieu réel de notre temps c’est la sainte Trinité État-Travail-Technique, qui exige tout de vous, en vous dispensant à la rigueur quelques grâces. » (Métamorphoses du bourgeois, Calmann-Lévy, 1967, p. 245-246 = Table ronde, 1998, p. 283). Et c’est pourquoi, si la technique est devenue sacrée, alors la seule attitude libre à son égard sera jugée « transgressive » à son égard ; cette « transgression à l’égard de la technique prendra la forme de la destruction des croyances que l’homme met dans la technique […]. Elle implique donc la recherche d’une signification externe au nom de quoi s’opère [cette] transgression et qui par là même dé-signifie la technique. » (« Recherches pour une éthique dans une société technicienne », 1983, repris dans Cahiers Jacques Ellul, 2004, p. 148)
[15] Comme je pense l’avoir montré ailleurs, cette obligation de moyens constitue la synthèse de la (démoralisante) morale technicienne actuelle, exclusive de la dimension personnelle et de la conscience. Morale technicienne en effet, pour un monde qui, par la science et la technique, a été objectivement réduit à un Univers de moyens. Cf. Jérôme Sainton, La morale technicienne, op. cit.
[16] Jacques Ellul, Le système technicien, p. 353 (= 2012, p. 328). « Le système technicien semble donner à l’homme un plus large champ de possibles, mais exclusivement inscrits dans ce champ technique, à condition que les choix portent sur des objets techniques et que cette indépendance utilise les instruments techniques : c’est-à-dire qu’elle exprime l’adhésion [à la technique]. » (p. 122 (= 2012, p. 119))
[17] Jacques Ellul, Le système technicien, p. 355 (= 2012, p. 329).
[18] Jacques Ellul, Le système technicien, p. 168 (= 2012, p. 161).
[19] Jacques Ellul, Éthique de la liberté (tome 1), 1973, p. 46. « C’est la technique [en effet] qui exige que les valeurs anciennes, les mœurs, la morale traditionnelle soient attaquées [, et] il y a erreur quand on croit qu’il y a [là] vrai non-conformisme (il exprime seulement le conformisme à la réalité la plus profonde et la plus forte). » (Le système technicien, p. 126 (= 2012, p. 122))
[20] « Il y a ceux qui vont au nom de la liberté délivrer les peuples d’on ne sait quelle dictature, quand ces peuples ne demandent rien. Et il y a ceux qui au nom de la liberté vous organisent une merveilleuse démocratie fondée sur la dynamique de groupe la plus conditionnante possible … […] Or, ces deux courants également bourgeois convergent de nos jours, cernent la totalité de l’homme, l’enserrent de partout, par le ventre et par les idées, par le rêve et par le pain, par la science et par l’action, pour lui faire mépriser, oublier, rejeter la liberté. […] Et ceci nous amène […] à considérer le sens et la valeur de l’entreprise bourgeoise en tant que développement de la puissance à l’état pur […] La puissance pour la puissance […] sans signification ni destination, [et qui] crée autour d’elle une abstraction rigoureuse. L’univers qu’elle habite et qu’elle crée n’est plus fait que de signes algébriques, de schémas, d’épures. Il n’y a plus d’êtres de chair et de sang pour elle, mais des hommes, des citoyens, des ouvriers, des instruments qualifiés par leur fonction et par leur rapport à la puissance. Il n’y a plus de rapports humains naturels : nous savons […] qu’ils sont tous “culturels”, et que l’homme par conséquent infiniment malléables peut être modifié, manipulé, transformé, ainsi que ses affections, ses haines, ses amours afin de le rendre conforme aux nécessités de la puissance. » (Métamorphose du bourgeois, Table ronde, 1998, p. 321-325)
[21] « Parce qu’au-dessus de nos têtes, à nous qui opérons ce libre choix, avant même notre libre choix, on a déjà tranché. On a déjà décidé que c’est en tant que consommateurs […] que nous devons opérer ce choix […] » (Günther Anders, L’Obsolescence de l’homme, 1956, p. 15).
[22] Le terme est de Benoît XVI. Et il n’est aucunement exagéré. Le fait par exemple que la prétention totalitaire du « Genre » ne soit pas liée à l’origine à un projet politique mais à la Technique ne change pas la nature de cette prétention — prétention en tout état de cause bien assumée par le gouvernement actuel, qui a refusé d’entendre jusqu’à l’objection de conscience, et qui a au contraire en vue de « préparer les consciences » c’est-à-dire les préparer à se confondre avec la doctrine du « libre-choix » : « le but de la morale laïque est de permettre à chaque élève de s’émanciper », de « donner la liberté de choix », ce pour quoi il faudra « arracher l’élève à tous les déterminismes, familial, ethnique, social, intellectuel » (Vincent Peillon, L’express, 02/09/2012). On ne saurait mieux résumer la loi morale de la société technicienne (nul doute que l’éducation à la technique — notamment à la contraception et aux PMA — ne souffrira, elle, d’aucun arrachement …). Là encore, Ellul l’avait annoncé : la formation à la technique (et à sa morale) « c’est tout le programme des réformes de l’éducation ! Mais qui dit cela, dit par-là même négation de toute autonomie spirituelle. Et nous pressentons le nouveau pas que, de partout, on attend : une éducation civique qui enfin en soit une, […] car le bon citoyen n’a pas à objecter en fonction de sa conscience individuelle […] mais à appliquer la morale sociale collective qui dans l’état actuel des choses est un produit de l’autonomie politique [de l’État technicien]. » (Jacques Ellul, L’illusion politique, 1977, p. 121-122).
[23] Ainsi dans le cas douloureux et grave de l’institutionnalisation de l’avortement comme dans celui de l’euthanasie : on ne cesse de défendre à leur endroit tantôt la liberté tantôt la nécessité : il faudrait savoir ! Mais c’était déjà le cas emblématique de la contraception, présentée comme le sommet évident à la fois de la liberté et de la nécessité modernes.
[24] « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui commet le péché est esclave du péché. » (Jn 8, 34)
[25] Jacques Ellul, L’espérance oubliée, La table ronde, 2004 (1972), p. 250, 255-256. Mais cf. aussi bien Benoît XVI, Sauvés dans l’Espérance, 2007, n.35, qui ne dit pas autre chose. Tout comme, sans surprise, l’élaboration d’une véritable « écologie humaine » (cf. www.ecologiehumaine.eu), dont l’expression et l’idée doivent beaucoup à l’Église catholique et particulièrement à Benoît XVI, rejoint toutes les perspectives dessinées par Ellul (et son grand ami Charbonneau) — dont l’écologie politique et environnementale, tout en prétendant s’y référer, a évacué tout ce qui faisait sens pour l’homme pour se voir admirablement récupéré par le système technicien (dans le « développement durable » notamment — « c’est ainsi que certains écologistes à tendance libertaire étaient très en marge, mais l’institutionnalisation de “l’environnement” a progressivement fait entrer dans l’organisation dominante un bon nombre de leurs tendances sans modifier en quoi que ce soit le système. Mais [ils] étaient trop heureux de se voir reconnus (par exemple la politisation de l’écologie par participation aux élections) » : Jacques Ellul, Déviances et déviants, érès, 2013 (1992), p. 144). Ainsi tirons-nous de notre trésor du neuf et de l’ancien (cf. Mt 13, 52), ainsi voyons-nous se rejoindre et sans couture sagesse catholique et sagesse protestante : ici l’analyse sociologique percutante d’Ellul rejoint toute la profondeur de la méditation philosophique personnaliste du catholicisme, et toutes les deux éclairent, par une raison ouverte à la transcendance, une seule et même théologie : Dieu seul libère et relie, face à l’Adversaire qui piège et divise.