Réflexions partagées avec Les Veilleurs de Reims, soirée du 10 mars 2020
De notre rapport à la vérité
Anna Geppert[1]
Chers amis,
Merci beaucoup pour votre invitation. C’est un honneur et un plaisir que de m’adresser à vous ce soir. Je ne parlerai pas de ma spécialité universitaire, la ville, que nous évoquerons avec Eric lors d’un ‘‘café philo’’à la médiathèque de Reims, vendredi 23 octobre prochain à 18h. Aujourd’hui, j’ai voulu prolonger la réflexion que vous avez déjà menée sur ‘‘Mensonges et manipulations’’, en partant de la question de Ponce Pilate : « Qu’est-ce que la vérité » ?
La question de la vérité est essentielle pour comprendre les difficultés de notre époque. Notre société, en se détournant de Dieu, perd toute référence à la vérité. L’émergence d’une société totalitaire et violente en est la conséquence inéluctable. Dans ces conditions, que devons-nous faire ? Tenir… Je terminerai par la lecture d’une méditation d’un grand témoin de la vérité, le bienheureux Jerzy Popiełuszko, prêtre et martyr.
-
Comment notre société a perdu le sens de la vérité.
Si je pose à un enfant la question de Ponce-Pilate, la réponse vient immédiatement : « La vérité, c’est ce qui est vrai ! ». Les enfants sont viscéralement attachés à la vérité, profondément bouleversés lorsqu’ils rencontrent, pour la première fois, le mensonge. Leur définition se retrouve dans celle du Petit Larousse (1998) :
- Caractère de ce qui est vrai ; adéquation entre la réalité et l’homme qui la pense.
Mais pour les adultes, comme pour notre société vieillissante, la vérité ne semble pas aller de soi.
Allons donc plus loin, avec la définition du Petit Robert (1992) :
- Ce à quoi l’esprit peut et doit donner son assentiment (par suite d’un rapport de conformité avec l’objet de pensée, d’une cohérence interne de la pensée) ; connaissance à laquelle on attribue la plus grande valeur (opposé à erreur, illusion). Théol. Dieu, fondement du vrai. (…)
Nous trouvons là deux niveaux, qui sont ceux de la philosophie thomiste. A un niveau surnaturel, transcendant, Dieu est la vérité. C’est pour cela que la vérité est une, absolue, immuable. Sur le plan terrestre, la vérité est définie par la conformité de l’intellect avec le réel. Cela implique que, dans la création, il existe une vérité que la raison humaine peut appréhender.
Telle est la mission de l’université, lorsqu’elle est fondée : chercher le vérité. À partir du XIIIe siècle, l’Église crée des universités. En leur sein, les facultés de théologie approfondissent la vérité révélée tandis que les autres facultés cherchent celle contenue dans la création. Dans l’Europe chrétienne du Moyen-Age, il va de soi que ces deux niveaux se rejoignent. L’Église n’a pas peur de la vérité, puisqu’elle va jusqu’à garantir aux professeurs l’indépendance de tout pouvoir, civil et religieux, afin qu’ils mènent à bien leur mission. La recherche de la vérité, aux yeux des hommes de ce temps, ne peut mener qu’à sa source, à Dieu.
Aujourd’hui, ces deux niveaux ont divorcé. Dans son discours de Ratisbonne du 12 septembre 2006[2], le pape Benoît XVI raconte cette séparation entre foi et raison. Emmanuel Kant, avec sa Critique de la raison pure, restreint le champ d’exercice de la raison à ce qui est mesurable : subséquemment, les sciences seront dominées par les sciences ‘‘exactes’’. Les encyclopédistes des pseudo ‘‘lumières’’ accentuent ce mouvement en proposant un référentiel qui se veut scientifique, construit sans Dieu et contre l’Église, dont l’esprit est encore largement présent dans les sciences humaines et sociales.
Le XIXe siècle abandonne l’idée que la vérité existe comme absolu. Kierkegaard la relie à la subjectivité, Nietzsche y voit une illusion collective, construite par la société :
Qu’est-ce que donc que la vérité ? Une multitude mouvante de métaphores, de métonymies, d’anthropomorphismes, bref, une somme de relations humaines qui ont été poétiquement et rhétoriquement haussées, transposées, ornées, et qui, après un long usage, semblent à un peuple fermes, canoniales et contraignantes : les vérités sont des illusions dont on a oublié qu’elles le sont… [3]
Que se passe-t-il alors ? La vérité n’existe pas, tout est relatif. Notre société s’est profondément imprégnée de cette idée. Mon Petit Larousse (1998) poursuit ainsi sa définition :
- Idée, proposition qui emporte l’assentiment général ou s’accorde avec le sentiment que quelqu’un a de la réalité. Vérités mathématiques.
Quel exemple ! Si tel est l’assentiment général (la voix de la majorité) ou mon sentiment subjectif (à chacun sa vérité), deux plus deux ne feraient plus quatre ?
Trouver cela dans un Larousse du siècle dernier m’a fait prendre conscience que cela fait bien longtemps que nous nous sommes habitués au « tout est relatif », au point, peut-être, de l’avoir intériorisé, de l’avoir fait nôtre. Il est devenu malséant de parler de vérité tout autant qu’il est devenu malséant de parler de Dieu, à tel point que nous-mêmes, nous n’osons pas toujours, publiquement, le faire. Dans notre combat contre les lois bioéthiques, pour atteindre un public large, de peur de gêner ‘‘certains’’, nous n’osons pas dire cette vérité : si la vie est sacrée, c’est parce que Dieu l’a établi ainsi. Malgré nos bonnes intentons, cette omission n’affadit-elle pas notre message ? Ne nous livre-t-elle pas à la dictature du relativisme ?
-
La dictature du relativisme
Dans l’homélie du conclave de 2005 qui devait l’élire, le futur successeur de Pierre, le cardinal Joseph Ratzinger mettait en garde :
Nous nous dirigeons vers une dictature du relativisme qui ne reconnaît rien pour certain et qui a pour but le plus élevé son propre ego et ses propres désirs.
Le terme dictature est-il trop fort ? Je ne le pense pas. En effet, je crois que le totalitarisme est l’aboutissement naturel d’un monde sans Dieu.
Sans une vérité absolue, trouvant son fondement en Dieu, il n’y a plus, ni réalité biologique (tout est construit, culturel), ni loi naturelle (tout est convenu, contractuel). On n’est plus homme ou femme, mais ce que l’on veut ou croit être, ou ce que l’on nous a donné à croire, comme dans la ‘‘théorie du genre’’. Qu’est-ce qu’un homme ? L’embryon, la personne handicapée, le mourant, sont-ils pleinement des hommes ? Leur vie vaut-elle d’être vécue ? La question est renvoyée aux ‘‘experts’’ des comités d’éthique nommés par le pouvoir politique, et au législateur qui tranchera, dans un sens ou dans l’autre, au gré des fluctuations de l’opinion et des rapports de force.
Aucune société ne peut fonctionner sans que ses membres partagent, à tout le moins, un socle de valeurs communes tenues pour vraies. En rejetant Dieu comme source de vérité, la société se condamne à définir elle-même sa vérité. Dans nos démocraties occidentales, il s’agira de la voix de la majorité, ou mieux, de ce qui fait consensus. Tant que l’héritage chrétien imprégnait les mentalités, nos sociétés occidentales tenaient encore, sur quelques valeurs implicites. Désormais, le vertige du vide se fait pleinement sentir. Les positions se radicalisent, les oppositions s’accentuent, la violence augmente.
Privés de l’assurance qu’il existe une vérité absolue, trouvant son fondement en Dieu, les individus aussi sont fragiles. Alors, on se tourne vers ce que l’on trouve, ce que nous propose notre smartphone. Dans notre société qui se voit trop moderne, trop intelligente pour croire, prospèrent experts, psychologues et gourous. Des pratiques irrationnelles prolifèrent, astrologie, magnétisme, hypnose, sophrologie, reiki, chamanisme… peu importe l’explication, du moment que cela procure du bien-être.
Les émotions se substituent à la raison. Des vagues de compassion, d’indignation, de panique, de colère déferlent, amplifiées par la caisse de résonance d’Internet : #jesuischarlie, #metoo, #SOS !
Nous entrons alors dans l’ère de la « post-vérité », dans laquelle (dictionnaire d’Oxford, 2016) :
les faits objectifs ont moins d’influence pour modeler l’opinion publique que les appels à l’émotion et aux opinions personnelles.
La crise du coronavirus nous en offre un miroir, avec ses informations contradictoires, ses mouvements de panique dans les magasins, ses mesures réduisant fortement les libertés individuelles adoptées sans contestation. Des pays de tradition aussi indisciplinée que l’Italie ou la France s’y plient sans discussion. Au-delà du coronavirus lui-même, nous assistons à l’expérimentation in vivo d’un nouveau modèle de gouvernement. Dans cette situation, que faire ?
-
Tenir.
Je me permets de m’appuyer sur les paroles de saint Jean-Paul II, prononcées dans l’homélie de sa messe d’intronisation, le 22 octobre 1978, et qui ont accompagné une génération de croyants :
N’ayez pas peur ! Ouvrez, ouvrez toutes grandes les portes au Christ !
N’ayons pas peur ! Car les petits enfants ont raison contre Nietzsche et Kierkegaard : la vérité existe. On peut tuer un homme, mais on ne peut pas éviter de mourir. Et si l’assentiment général ou une perception subjective prétendait le contraire, ce serait une illusion.
N’ayons pas peur ! Car au-delà des moyens technologiques puissants qu’il mobilise aujourd’hui, le combat contre la vérité qui se livre aujourd’hui n’est rien d’autre que le combat éternel contre Dieu. Au fond, ce qui nous désempare aujourd’hui, c’est ce qui désemparait nos aïeux. Ce n’est pas la vérité qui est subjective, c’est nous, c’est l’expérience que chacun de nous doit vivre dans sa vie terrestre.
Contrairement à Ponce-Pilate, nous connaissons la réponse à sa question. Notre Seigneur Jésus Christ est « la Voie, la Vérité et la Vie » (Jean, 14,6). Il est vainqueur à jamais, du mal, du mensonge et de la mort. Notre Dame écrasera la tête du serpent. N’ayons pas peur !
Je terminerai par la lecture d’une méditation d’un grand témoin de la vérité.
Le bienheureux Jerzy Popiełuszko (1947-84), prêtre polonais, fut enlevé par les sbires du pouvoir communiste le 19 octobre 1984 et torturé jusqu’à la mort en haine de la foi. Peu de temps auparavant, j’ai eu l’honneur de le rencontrer, car il visitait ma grand-mère, handicapée, qui était dans sa paroisse. Il a été béatifié en 2010. Son intercession obtient de nombreuses grâces et des miracles. Le miracle retenu pour sa canonisation a eu lieu en 2012… à Créteil.
Le texte que nous allons lire provient de ses derniers mots. Le 19 octobre 1984, il pria le chapelet à l’église des Saints Martyrs polonais, à Bydgoszcz. Il fut enlevé sur le chemin du retour. C’était un vendredi, les mystères médités étaient les mystères douloureux. À chaque mystère, il avait associé une interrogation essentielle de l’homme. Dans le troisième mystère, il médite sur la vérité.
* Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen.
Troisième mystère douloureux.
Être vainqueur du mal par le bien, c’est demeurer fidèle à la Vérité. La vérité est une propriété très délicate de notre raison. Dieu lui-même a implanté dans l’homme un désir naturel de vérité, et une répulsion pour le mensonge. Tout comme la justice, la vérité est liée à l’amour. Or, l’amour coûte – le véritable amour est sacrificiel. Donc la vérité, aussi, doit coûter. Le vérité réalise toujours l’unité et l’union entre les hommes. La grandeur de la vérité intimide et démasque les mensonges des hommes médiocres et craintifs. Depuis des siècles, le combat contre la vérité dure sans cesse. Mais la vérité est immortelle, tandis que le mensonge périt d’une mort rapide. Voilà pourquoi, selon les mots du défunt cardinal Wyszyński, il n’y a pas besoin d’un grand nombre de personnes pour dire la vérité. Le Christ a choisi un petit nombre de disciples pour annoncer la vérité. Le mensonge doit se parer de beaucoup de mots, car il est épicier : il faut sans cesse le renouveler, comme la marchandise dans les rayons. Ik doit être toujours nouveau, il doit avoir beaucoup de serviteurs qui, selon le programme, l’apprendront pour un jour, une semaine, ou un mois. Ensuite, on inculquera rapidement un autre mensonge. Il faut beaucoup de personnes pour contrôler toute l’ingénierie du mensonge programmé. Il n’en faut pas autant pour dire la vérité. Les hommes trouveront, les hommes viendront de loin pour trouver des paroles de vérité car il y a, au fond de l’homme, un désir naturel de vérité.
Nous devons apprendre à distinguer le mensonge de la vérité. Ce n’est pas facile, dans les temps où nous vivons. Ce n’est pas facile, dans ces temps dont un poète contemporain a dit que « jamais encore, on n’avait fouetté si cruellement nos dos avec le fouet du mensonge et de l’hypocrisie ». Ce n’est pas facile, quand la censure supprime les paroles vraies et les pensées courageuses, surtout dans la presse catholique, quand elle élimine jusqu’aux paroles du Primat de Pologne et du Saint-Père. Ce n’est pas facile, quand on interdit aux catholiques, non seulement de combattre les opinions de leurs adversaires, mais même de défendre leurs convictions, personnelles ou universelles, face aux attaques et aux calomnies les plus iniques. Il est interdit aux catholiques de rectifier les faussetés que d’autres ont entière liberté de proclamer et de propager impunément. Ce n’est pas facile, quand depuis plusieurs décennies on a ensemencé la terre de notre patrie avec les graines du mensonge et de l’athéisme. Le devoir du chrétien est de prendre parti pour la vérité, quand bien même il faudrait payer pour cela un prix élevé. Car la vérité coûte cher, seule la paille ne coûte rien.
Prions pour que la vérité remplisse notre vie quotidienne.
Amen.
[1] Professeur des universités, Sorbonne Université
[2] On trouvera une belle sélection de discours du Pape Benoît XVI, réunis et introduits par l’abbé Eric Iborra, dans : Benoît XVI (2013). Discours au monde. Eds. Artège, 127p.
[3] Friedrich Nietzsche, Le livre du philosophe, trad. A. Kremer-Marietti, Flammarion, coll. GF, 1991, p. 123-124.
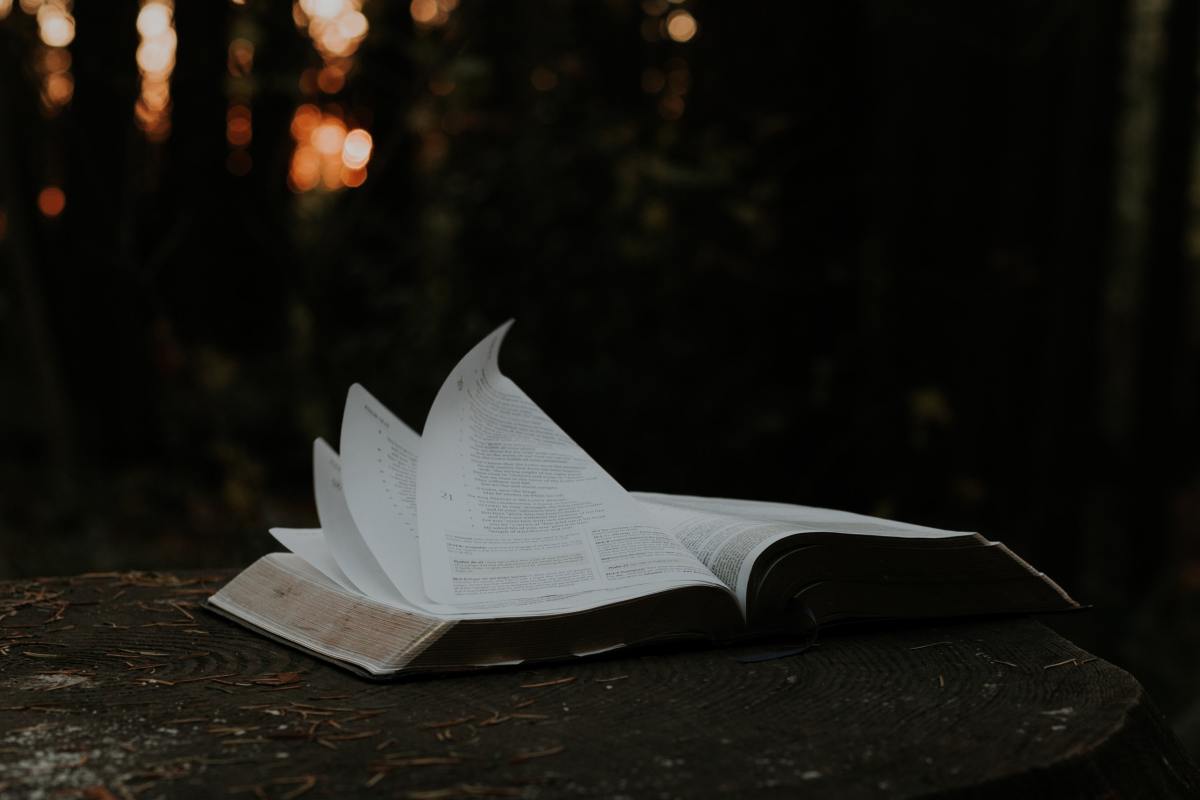
Bonjour Eric,
merci pour cette réflexion partagée sur ce sujet essentiel.
A noter que « La vérité est la subjectivité », selon Kierkegaard n’est pas l’apologie du relativisme, mais signifie plutôt « Je suis moi-même dans la vérité, je suis moi-même « vrai », si ma vie s’accorde avec la Vérité avec un grand V ».
La vérité n’est donc pas une simple idée, mais bien la norme qui mesure mon existence. Jésus est « le véritable et la vie éternelle » cf 1 Jean. Pour un croyant comme Kierkegaard, il n’y avait pas de plus grande capacité humaine que d’exister en toute vérité selon la Vérité éternelle. Et la tache de l’enseignement, selon lui, consiste à « communiquer la vérité éthico-religieuse », soit d’aider autrui à vivre selon Dieu.
Fraternellement,
Pep’s
J’aimeAimé par 1 personne
Merci pour ce commentaire pertinent cher Pep’s … Avec mes amitiés …
J’aimeJ’aime
Cher « Pep’s »,
Merci pour votre lecture et pour votre commentaire. Assurément, Kierkegaard est lui-même chrétien et ne cherche pas à faire une apologie du relativisme. Tel ne voulait pas, d’ailleurs, être mon propos. Je place simplement Kierkegaard sur une trajectoire qui, au cours du XIXe siècle, conduit à ce que c’est in fine l’homme, plutôt que Dieu, qui définit la vérité. Dans la pensée de Kierkegaard, c’est le concept de vérité subjective, qui mène à une incertitude fondamentale:
« L’incertitude objective appropriée fermement par l’intériorité la plus passionnée, voilà la vérité, la plus haute vérité qu’il y ait pour un sujet existant. (…) la vérité consiste précisément dans ce coup d’audace qui choisit l’incertitude objective avec la passion de l’infini » (Post scriptum aux miettes philosophiques). »
Je pense qu’il se trompe. Loin de moi l’idée de lui faire un procès d’intention! Il me semble plutôt qu’il a été une véritable caisse de résonance des doutes de son époque, et de l’angoisse profonde qui les accompagne.
Bien amicalement,
Anna Geppert
J’aimeAimé par 1 personne